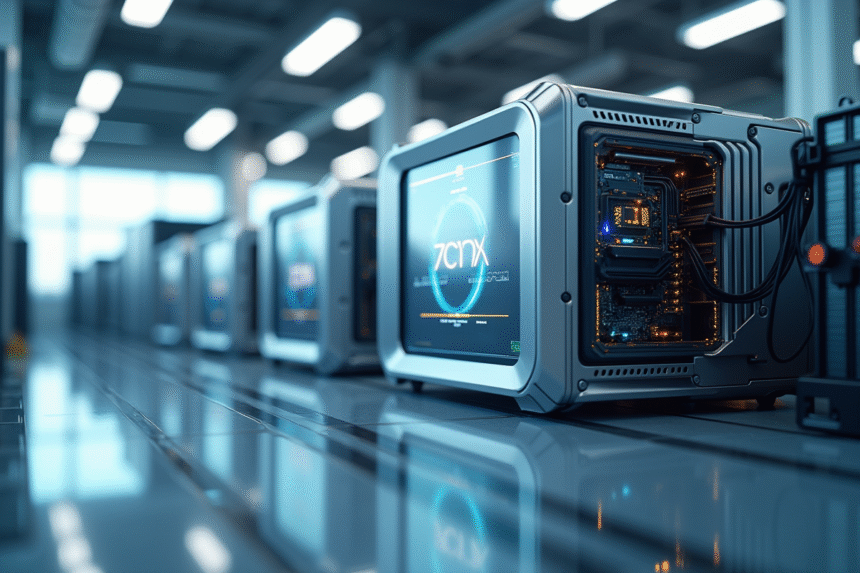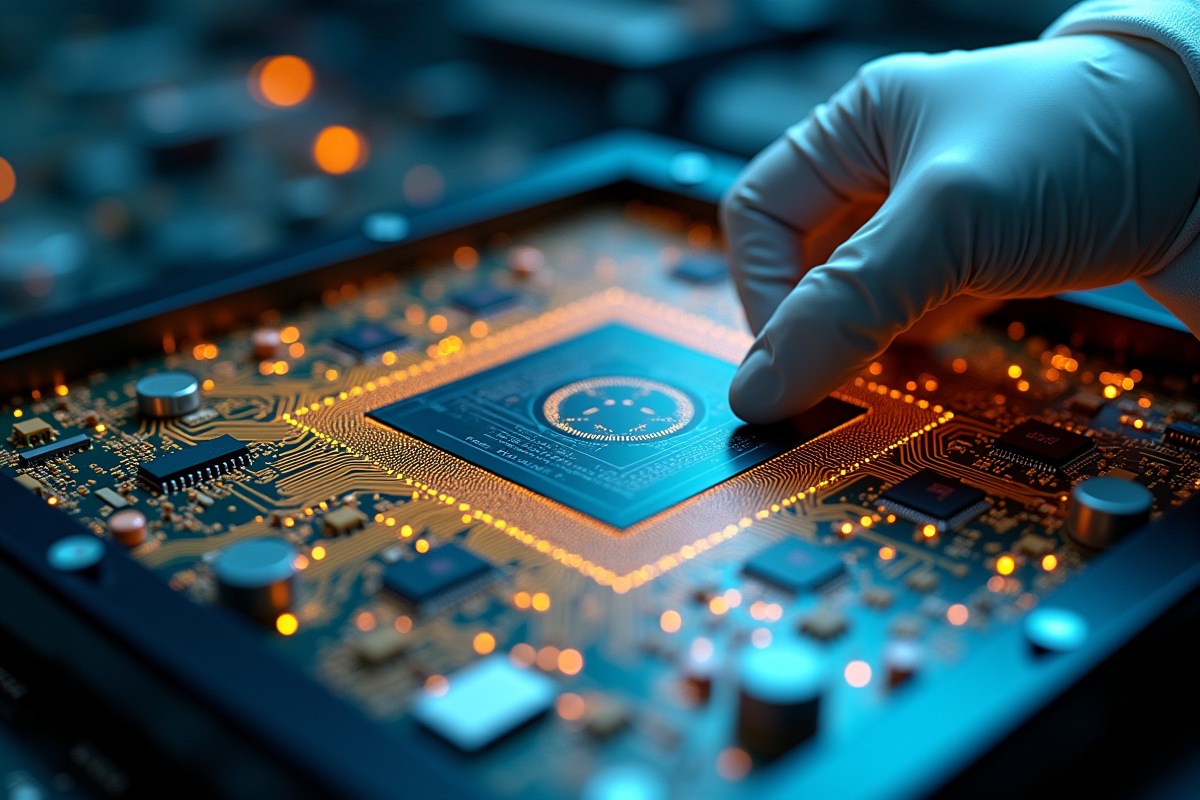La course à la suprématie quantique ne suit ni calendrier linéaire, ni logique industrielle classique. Chaque annonce majeure bouleverse les classements établis, rendant toute hiérarchie temporaire.
Atom Computing, IBM et Microsoft redéfinissent sans cesse la notion de puissance, en s’appuyant sur des architectures radicalement différentes. Derrière les chiffres affichés, des enjeux scientifiques et industriels se dessinent, redessinant les contours de la recherche appliquée et des capacités de calcul à venir.
Ordinateurs quantiques : où en est la course à la puissance ?
Le terrain du calcul quantique change de visage à toute vitesse. Chaque mois, de nouveaux records tombent, bousculant la hiérarchie. Dernièrement, Atom Computing a fait sensation avec un prototype d’ordinateur quantique réunissant 1 180 qubits. Un score qui surpasse les 433 qubits du processeur Osprey d’IBM. L’entreprise américaine ne reste pas immobile : le lancement de Condor (1 121 qubits) se profile, tandis que le QPU Kookaburra (1 386 qubits) se prépare déjà en coulisse.
Pourtant, la bataille ne se limite pas à l’addition de qubits. Le volume quantique et la vitesse d’exécution deviennent des critères décisifs. Quantinuum sort du lot avec son H2-1 : seulement 56 qubits, mais une rapidité qui enterre le Sycamore de Google (54 qubits). La qualité des qubits, la capacité à corriger les erreurs, l’organisation même des processeurs quantiques : voilà le cœur du défi. Quandela, grâce à Bélénos et ses 12 qubits photoniques, prouve qu’il n’existe pas une voie unique : supraconducteurs, photons, atomes neutres, ions piégés se disputent la scène.
La Chine n’observe pas la compétition de loin. L’université de sciences et technologie (USTC) aligne Juizhang, une machine photonique qui rivalise déjà avec des supercalculateurs classiques. Avec Zuchongzhi (66 qubits), les chercheurs chinois repoussent encore les frontières de l’expérimentation, s’appuyant sur les qubits Transmon. La compétition mondiale s’intensifie, chaque équipe cherchant à s’imposer par l’innovation technique et la pertinence de ses algorithmes.
Qui détient aujourd’hui le titre d’ordinateur quantique le plus puissant du monde ?
À ce jour, le sceptre du calculateur quantique le plus puissant du monde revient à Atom Computing et ses 1 180 qubits. Un pallier qui place la société devant IBM et son Osprey (433 qubits). La riposte s’organise déjà avec Condor (1 121 qubits) et le futur QPU Kookaburra (1 386 qubits), mais pour l’instant, la barre des mille qubits reste le terrain d’Atom Computing, leader sur le critère de la densité de qubits.
Cependant, le paysage ne se résume pas à une simple course aux chiffres. Quantinuum impose sa rapidité : son H2-1 (56 qubits) exécute certains calculs cent fois plus vite que Sycamore de Google (54 qubits), avec un score XEB de 0,35, symbole de stabilité. Côté chinois, l’USTC aligne Juizhang et Zuchongzhi : Juizhang, fondé sur la photonique, aurait franchi un cap majeur, atteignant une efficacité de calcul dix milliards de fois supérieure à Sycamore selon ses créateurs.
Voici les machines qui dominent la compétition actuelle :
- Atom Computing : 1 180 qubits (prototype, record du moment)
- IBM : Osprey (433 qubits), Condor (1 121 qubits à venir), Kookaburra (1 386 qubits en préparation)
- Quantinuum : H2-1, 56 qubits, mais des performances hors normes
- USTC : Juizhang, Zuchongzhi (66 qubits, 56 utilisés)
Le titre de quantique le plus puissant se dispute donc sur plusieurs critères : densité de qubits, rapidité d’exécution, robustesse face aux erreurs. Mais côté nombre de qubits, Atom Computing occupe aujourd’hui la première place.
Atom Computing, IBM, Microsoft : des approches technologiques qui font la différence
Sur le terrain du calcul quantique, chaque entreprise trace sa propre route. Atom Computing mise sur les atomes neutres d’ytterbium, piégés et contrôlés par faisceaux laser. Cette méthode permet d’aligner un grand nombre de qubits tout en limitant les interférences. La stabilité, point de blocage du secteur, devient ainsi un objectif prioritaire pour passer du prototype à l’ordinateur de recherche opérationnel.
Du côté d’IBM, c’est la technologie Transmon qui domine : des circuits supraconducteurs refroidis à des températures proches du zéro absolu. Cette approche a permis à IBM de mettre au point Osprey (433 qubits) et de préparer l’arrivée de Condor (1 121 qubits). IBM travaille aussi sur l’interconnexion de processeurs quantiques pour démultiplier les capacités. Objectif affiché : créer un supercalculateur quantique de 4 158 qubits d’ici 2026.
Quant à Microsoft, la stratégie diffère. L’entreprise choisit la virtualisation de qubits et s’appuie sur la création de qubits logiques avec Quantinuum. L’idée : fiabiliser les calculs en compensant les erreurs des qubits physiques. Microsoft ne fabrique pas encore ses propres processeurs, mais s’impose dans le paysage logiciel et algorithmique, tissant des partenariats stratégiques avec Atom Computing et Quantinuum.
Les choix technologiques divergent : atomes neutres, ions piégés, photons, supraconducteurs… Mais la bataille se joue toujours sur la capacité à stabiliser, connecter et faire évoluer le processeur quantique à l’échelle industrielle.
Quelles perspectives pour la recherche et l’industrie face à ces avancées inédites ?
L’apparition de machines quantiques inédites bouleverse les repères de la recherche scientifique et du secteur technologique. À Massy, Quandela propose déjà un accès à son système Bélénos via le cloud. Résultat : plus de 1 200 chercheurs et entreprises issus de 30 pays testent des algorithmes quantiques sur des qubits photoniques. L’Europe occupe une place de choix et concentre deux tiers des utilisateurs, mais l’Amérique du Nord et l’Asie accélèrent aussi.
L’intégration d’ordinateurs quantiques dans les centres de calcul prend forme. D’ici fin 2025, une machine Quandela rejoindra le TGCC du CEA sous la bannière EuroHPC/GENCI. Les industriels se mobilisent. Le BMW-Airbus Challenge, remporté par Quandela, témoigne de la pression stratégique dans l’aéronautique et l’automobile. Quantinuum multiplie les projets avec Microsoft ou JPMorgan Chase & Co, ouvrant la voie à des usages dans la finance, la chimie ou l’optimisation industrielle.
Les ambitions du secteur se concrétisent à travers plusieurs axes :
- création d’algorithmes hybrides associant calcul classique et quantique ;
- élargissement des accès via le cloud computing ;
- accélération de la découverte de nouveaux matériaux et molécules.
Quandela prépare déjà Canopus (24 qubits photoniques) et vise les 40 qubits à trois ans, promettant un saut décisif. La France, portée par des acteurs comme Quandela, se hisse parmi les leaders, soutenue par des alliances avec le CEA, le CNRS et ses partenaires européens.
D’ici peu, la frontière entre rêve quantique et applications tangibles s’amenuisera encore. Certaines certitudes d’aujourd’hui seront balayées demain : voilà tout le sel de la révolution quantique en marche.